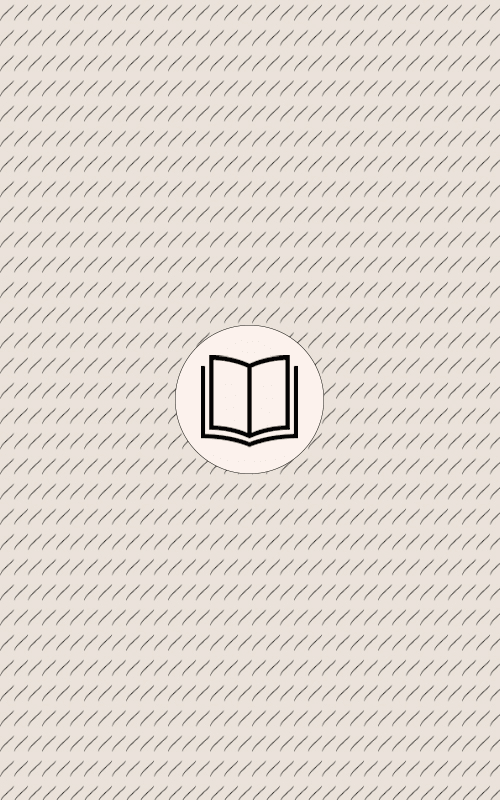Pour tendre un miroir aux faits dans leur implacable nudité, Maria Malagardis, grand reporter à Libération qui a couvert le génocide des Tutsi au Rwanda, prend des détours féconds : le recul du temps, qui a permis de mettre au jour les responsabilités, et nous fait remonter jusqu’à l’imminence des événements – avoir attendu qu’advienne cet « après » –, l’aide aujourd’hui à s’enraciner sans fard dans l’avant ; le choix de la forme romanesque ; celui, enfin, de ne pas nommer le pays et les ethnies en présence, pour faire advenir la catastrophe sous nos yeux en une « lave silencieuse ». Frontale. Flagrante.
A partir du meurtre de six enfants, en novembre 1993, l’enquête de deux casques bleus déroule un écheveau de forces visibles et invisibles, à mesure que la haine de l’« ethnie majoritaire » pour la « minoritaire » empoisonne les consciences, au vu et au su de tous. Le roman se fracasse contre cette menace, processus insupportable qui mènera, entre avril et juillet 1994, à une extermination pourtant annoncée par ses commanditaires, reposant sur une manipulation à grande échelle.
Maria Malagardis fait, de l’assassinat de ces enfants par le pouvoir, qui s’en dédouane en accusant les rebelles, la préfiguration du meurtre d’un million de personnes. Arachnéenne, l’enquête dévide une mécanique tragique, soulignant le rôle de chacun (le régime, la France, l’Eglise catholique).
En ne nommant pas comme tels Tutsi et Hutu, le roman pointe l’ethnicisation artificielle du conflit qui a déchiré le Rwanda au XXe siècle. Pour rendre leur intégrité aux victimes du génocide, il dissout en actes la propagande raciste, faisant advenir, dans le langage même, la réunion de ces deux ethnies au sein d’un même peuple.