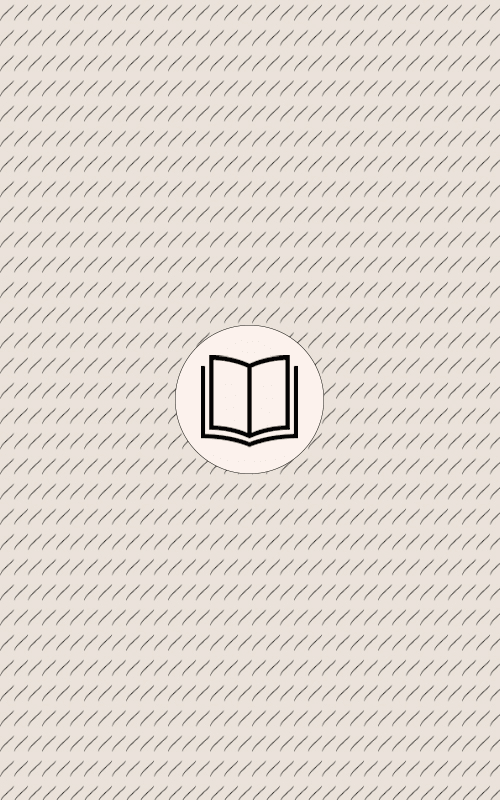Mieux qu’un empire, une légende ! L’histoire des Vanderbilt aux États-Unis tient de la grande saga familiale et du roman capitaliste. Elle célèbre l’esprit d’entreprise, le talent du fonda-teur de la lignée, Cornelius Vanderbilt, l’argent qui n’est pas un problème puis-qu’on ne le compte plus. Elle met en scène des ambitions, des mariages, des querelles, des châteaux et des palais, un pays et ses bâtisseurs, et un arbre généa-logique plus large qu’un chêne pluricen-tenaire. Vanderbilt fait partie des mythes d’outre-Atlantique. Il fallait bien être deux pour aborder ce livre d’or qu’on pourrait sous-titrer « Grandeur et décadence ». Au premier chef, Anderson Cooper, présentateur vedette de CNN mais surtout fils de l’étincelante Gloria Vanderbilt, décédée à 95 ans en 2019 après une vie de gala. Son témoignage se veut de première main. Il est écrit de l’intérieur. Pour l’épauler, il a fait appel à l’historienne et romancière Katherine Howe. Il en résulte un livre foisonnant sur l’Amérique en pleine ascension, terre de milliardaires audacieux. Les Vanderbilt en font partie. On les côtoie au fil de chapitres ressemblant à des limousines de luxe. Sur place, leur nom a longtemps valu blanc-seing pour accé-der au club très fermé des familles par-mi les plus riches du monde, au même titre que les Rockefeller à leur époque.
UN FONDATEUR PINGRE ET GÉNIAL QUI AMASSE UNE FORTUNE
Au début se profile un visionnaire en-treprenant. Cornelius est le 4e enfant d’une famille de Staten Island, né en 1794. Ses lointaines origines le ra-mènent en Hollande, dans le village De Bilt, en province d’Utrecht, fin du XVIIe siècle. On a ajouté une particule « van der » pour se nommer « van der Bilt » réduit à un plus réaliste « Vanderbilt » lorsque les Anglais s’emparent de La Nouvelle-Amsterdam. Cornelius a du nez, mais pas de classe. On le décrit comme un indécrottable radin. Il quitte l’école à 11 ans pour devenir un des hommes les plus riches des E.U. Son domaine ? Les liaisons maritimes et ferroviaires dont il tisse habilement la toile au XIXe siècle. En 1875, deux ans avant sa mort, il lance la construction d’une ligne de chemin de fer dans le Michigan, le Michigan Central Railroad. Il mise aussi sur le trafic maritime au point de détenir plus de bateaux que l’US Navy. Il crève les plafonds et de-vient un moment plus riche que le gouvernement américain.
Les Vanderbilt deviennent la figure de proue de cette nouvelle aristocratie du commerce et des affaires. Ils alimentent et profitent du « Gilded Age », cet âge d’or faisant de l’Amérique le point central à conquérir… pour s’enrichir. Constat des auteurs : « Les Vanderbilt,qui ont été les premiers arrivistes à contribuer de telle manière à l’empire du nouvel argent, ont utilisé leur richesse pour acheter le prestige et le respect. Ils ont liquidé leur fortune non pas pour procéder à des changements durables, mais à de massifs exutoires menant à une consommation ostentatoire. Les millions de dollars des Vanderbilt ont permis d’acheter des demeures palatiales, des voiliers renversants, des voi-tures par centaines, et des bijoux à la fois magnifiques et rares ». Tout l’inverse du patriarche Cornelius, dénoncé pour sa radinerie viscérale.
LES AUTEURS CREUSENT LE SILLON DE CETTE DYNASTIE IVRE D’ELLE-MÊME
On plonge alors dans ce récit « entre fulgurante ascension et chute foudroyante », hors sol, à des niveaux extravagants, dans une sorte de « Great Gatsby » à l’indice 100. Rien n’est trop beau, trop cher, trop fou et surtout rien n’est impayable. Seul manquement, le clan ne possède pas l’essentiel aux yeux de l’aristocratie de la côte Est : les lettres de noblesse, la consécration des pairs, la respectabilité. Il faudra l’acheter et la signifier dans la pierre avec des de-meures qui sont d’authentiques palais, où tout le mobilier vient de France, dans des décors à l’italienne d’un prix inouï. Les Vanderbilt sont richissimes et en quête de reconnaissance, ce patrimoine immatériel. Ils deviennent des personnalités en vue. Le « New York Times » relate leurs sorties mondaines. Car bien sûr, ils s’établissent à New York, « Le Petit Château » et ses 130 pièces sur la Cinquième Avenue. Les millions de dollars volent. On donne des fêtes somptueuses au manoir et dans la résidence d’été de Newport ; on rayonne jusque dans les cours européennes. Les héritiers cherchent à s’ancrer dans l’élite. Le 26 mars 1883, Alva et William Vanderbilt organisent le bal le plus extravagant jamais conçu. William, le fils de Cornelius surnommé « Le Commodore », n’a pas le même sens des économies que l’auteur de ses jours. Il est passionné de chevaux et possède de nombreuses écuries. Alva veut frapper un grand coup. On dépense 250.000 dollars de l’époque pour ce « grand soir ». Il doit tenir lieu d’événement dans une ville qui en a pourtant l’habi-tude et assurer la suprématie du nom. On convie 1.200 invités triés sur le volet. En fait, on gaspille l’argent, on le jette par les multiples fenêtres, on dila-pide la fortune. Les Vanderbilt font désormais partie de la haute société et tout le monde a oublié les mauvaises manières de Cornelius.
LA LENTE DÉCHÉANCE
La bonne fortune se poursuit un peu au XXe siècle. L’Amérique n’est-elle pas alors le phare du monde ? Les Vanderbilt y évoluent encore en grands seigneurs de la finance et de l’économie. Leur vie constituerait la trame idéale pour une superproduction à Hollywood ou une série à succès sur Netflix. On s’y adonne encore aux plaisirs les plus fastueux, courses de bateaux et fêtes monumentales. Le nom demeure comme un bristol pour briller, dans le parfum d’antan, mais l’argent ne coule plus à flots. Les années 20, les années 30 ont épuisé les réserves. La dernière digne représentante de la dynastie règne en-core comme une diva sur la mode mais le capital de magie donne des ratés. Gloria Vanderbilt (la mère d’Anderson Cooper) tient fermement son rôle d’héritière. Elle se lance dans les affaires qu’elle résume du seul étalon qui vaille : « L’argent que j’ai gagné a pour moi une réalité que l’argent hérité n’a pas. » Elle entretient la flamme. Se marie quatre fois, notamment avec Sidney Lumet, le réalisateur de « Douze hommes en colère ». On lui prête des amants, et non des moindres : Frank Sinatra, Gene Kelly, Marlon Brando, Howard Hughes. Elle vit un drame lorsque son fils Carter se jette par la fenêtre devant ses yeux en juillet 1988. Elle est belle, a le charme d’une héroïne et inspire Audrey Hep-burn dans « Breakfast at Tiffany’s ». L’empire n’est plus ce qu’il était, mais bien son pouvoir d’évocation…
Par Bernard Meeus pour SoirMag.