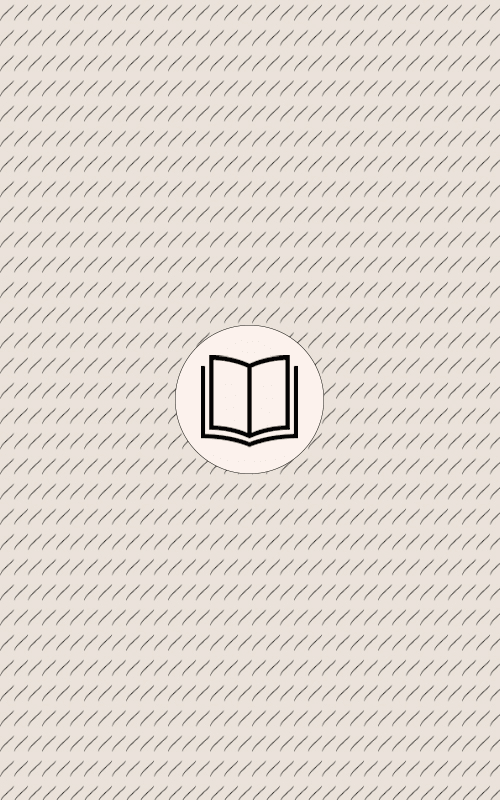Pourquoi ce nouveau livre ?
J'avais écrit quatre livres. Je pensais que c'était terminé. Je croyais avoir tout dit. Puis avec le confinement, je me suis beaucoup retrouvé tout seul. Un jeune journaliste et écrivain, Alexandre Alain, m'a proposé de faire un livre. Il avait un éditeur. Il est originaire de l'Yonne et il connaissait l'histoire de l'AJ Auxerre mieux que moi. J'ai réfléchi, je me suis demandé si j'avais encore des choses à dire. Puis j'ai dit oui, et ça a donné ce livre, beaucoup plus riche que les précédents. Plus libre, aussi. Les précédents, j'étais encore en activité, j'étais obligé de me retenir sur certains sujets.
Dans votre famille, il y avait des paysans et des militaires. Votre père, notamment, avait été officier. Une fois devenu entraîneur, on évoquait beaucoup votre "bon sens paysan" et votre côté strict avec vos joueurs. Au fond, l'entraîneur Guy Roux ne doit-il pas beaucoup au contexte dans lequel vous avez grandi ?
Pour le côté France profonde, paysan XIXe siècle, oui. Mon grand-père, qui était né en 1881, et qui est mort en 1981, a beaucoup compté. Si je suis revenu à Auxerre, c'était pour lui et ma grand-mère, qui m'avaient élevé. J'avais juré que je resterais tant qu'il serait là. Ce que j'ai fait. J'ai beaucoup parlé avec lui. Il m'a raconté son enfance de 13e enfant d'une famille de 18 paysans. Ce sont des gens qui avaient le souci d'éviter la famine. Cette vie-là m'a beaucoup impressionné. Mon grand-père a été mobilisé à 33 ans, il a été blessé puis prisonnier pour cinq ans en Poméranie. Mon père, qui a fini lieutenant-colonel, a lui été prisonnier plus tard dans un camp d'officiers en Poméranie. Tout ça m'a fait jouir de ma liberté. Bien sûr que ça a beaucoup influé sur ma personnalité.
Ce côté paysan, que l'on vous renvoyait parfois comme une marque de mépris, était donc plutôt une fierté pour vous ?
Oui. Quand on allait au Parc des Princes et que le public chantait "paysan, paysan", quand j'apparaissais, c'était un compliment pour moi. J'étais même indigne de recevoir ça, je ne sais même pas cultiver la terre !
Vous êtes arrivé sur le banc de l'AJA à 23 ans. Mais il a fallu près de 20 ans pour qu'elle accède à la première division. Quand avez-vous commencé à croire au potentiel du club ?
Très tard. Et très progressivement. A chaque fois, on a pris notre temps. On était en DH. Ça a duré dix ans. Puis en D3. On était contents. Jamais le club n'y était jamais allé. Là, on y est resté quatre ans. Toujours bien classés. Après, ça a été la D2. 10e, 9e, 8e, et plusieurs années dans les cinq premiers. Puis 3e et, enfin, la première place. On a donc eu le temps de se préparer. Mais c'était insensé. Une ville de 37000 habitants, avec un stade, au départ, de 300 places.
Le plus insensé, c'est la façon dont l'AJA, sous vos ordres, va s'installer dans l'élite, et presque toujours sur les hauteurs du classement...
On a joué que deux fois le bas du tableau. La deuxième année, on termine 15e. Et en 2000, quand j'ai eu mon burnout, ma dernière année avant ma coupure.
Mais une 15e place, c'était une anomalie, alors qu'au regard des moyens du club, cela aurait dû constituer la norme, non ?
Les moyens... Les moyens intellectuels du club étaient très au-dessus des autres. Tout ça découlait d'une méthode. Dans le savoir-faire, on était bien meilleurs que beaucoup. J'avais créé une méthode de gestion sportive, qui faisait que chaque année, nous changions deux ou trois joueurs, en gardant notre base. Après, soit on révélait des talents inconnus qui allaient finir en équipe de France, comme Laslandes, soit on saisissait une occasion qui passait, un joueur que personne n'avait saisi. C'était Scifo, ou Laurent Blanc. La conjonction de ces deux éléments, plus une méthode de travail très personnelle, nous a amenés très haut.
C'était quoi, cette méthode personnelle ? Donnez-nous un exemple.
Mon utilisation de l'altitude, par exemple. Personne ne la conteste, aujourd'hui. Aucun marathonien ne passe plus d'un mois de l'année à moins de 2000 mètres. Alaphilippe se prépare en altitude pendant deux mois. C'est une amélioration naturelle de la performance physique. Mais personne ne s'en servait à l'époque.
Vous parliez de ces "occasions" à saisir. Scifo et Blanc, ce sont les deux plus beaux, les deux plus gros ?
Ce sont les plus spectaculaires, parce qu'ils étaient déjà des stars. Mais pour moi, le plus beau, c'est quand on allait découvrir un talent. Comme Eric Cantona.
Comment l'avez-vous déniché ?
J'avais un ouvrier d'usine qui, dans tous ses jours de congés, voyageait à travers la France pour suivre des stages de jeunes joueurs. Un jour il me téléphone. C'était un lundi, à midi et demi. Il avait voyagé tout le dimanche pour aller à Aix-en-Provence. Il me dit "Ecoute, il y a un phénomène extraordinaire, il s'appelle Cantona". Je lui demande de me trouver le nom du président de son club, de son éducateur, l'adresse de ses parents, leur métier, tout. Et je lui dis de me rappeler le soir pour me faire une fiche complète. Le dimanche suivant, j'étais aux Caillols, pour voir les parents de Cantona. Et je n'ai plus lâché. Un mois plus tard, il était chez nous.
Pour attirer ce genre de talents, vous deviez leur montrer plus d'attention que les autres, en somme…
Vous savez pourquoi Cantona est venu chez nous ? Il le raconte dans son livre. Il hésitait entre Auxerre et Nice. Il a demandé un maillot du club à Nice. On lui a dit de passer à la boutique. Ses parents ont dû faire un chèque. Quand il m'a demandé s'il pouvait avoir un maillot de l'AJA, un quart d'heure après, je lui en donnais un. Ça tient à ça, aussi...
Dans la longue liste de talents passés par Auxerre, Cantona tient-il une place à part ?
Comme personnage, c'est sûr. C'était un caractère difficile pour un manager. Mais avec des bons côtés. Il avait déjà du cœur, de la générosité et un sens aigu de la justice. J'ai discuté avec des gens qui ont travaillé avec lui sur des films ou des séries, il a toujours ce même sens de l'humanité. Il n'engueulera jamais un troisième couteau sur un plateau. S'il s'engueule avec quelqu'un, ce sera avec le réalisateur, pas avec un cadreur ou un maquilleur.
Et le joueur, quel souvenir gardez-vous de lui ?
Exceptionnel. Une classe... Et un joueur complet. Il avait les deux pieds, la tête, le jeu de corps, l'endurance. Il avait tout. Ce que Maradona a fait contre l'Angleterre, il nous l'a fait quelquefois. Il partait de nos 18 mètres, dribblait cinq joueurs et mettait le but.
Il y a aussi eu les joueurs en qui pas grand-monde ne croyait, que l'AJA a amené très haut, parfois jusqu'en équipe de France...
Parfois, on me disait "Comment tu as fait pour deviner que (Lilian) Laslandes serait international alors qu'il avait les pieds complètement carrés quand il jouait à Saint-Seurin ?" C'est le métier ! Moi, quand j'allais manger chez Bernard Loiseau, quand il faisait une sauce, qu'il mettait le condiment en le tenant entre le pouce et l'index, il n'y avait que lui pour savoir la quantité exacte nécessaire. Moi, j'en aurais mis trop ou pas assez.
Il n'y a que du "métier" derrière ça, ou une part d'intuition ?
J'avais une énorme confiance dans mon jugement. On peut se tromper, bien sûr, toujours. Mais je croyais en mon intuition. Comme dans l'histoire de (Gérald) Baticle. Il était en D4, à Amiens. Un type, un gars que je connaissais à peine, un représentant de commerce, me dit qu'un mec a mis 35 buts en D4. J'envoie un de mes gars à Amiens. Il revient, Baticle n'a pas marqué, il me dit qu'il n'est pas très mobile, qu'il a une jolie technique mais c'est vraiment tout.
Pourtant, vous l'avez quand même pris...
Oui, sans le voir jouer. Je l'ai appelé et au téléphone, en cinq minutes, il m'a fait très bonne impression. Je suis allé le voir. On s'est vu dans un restaurant sur l'autoroute. On n'a parlé que de football, pas d'argent. Pendant deux heures. Il était apprenti prof de gym. Une semaine après, je suis revenu, il était avec son père, qui avait été joueur aussi. Le père me dit qu'il est boulanger. Alors je lui dis 'Vous étiez avant-centre'. Dans les villages, l'avant-centre était toujours un boulanger, il fallait qu'il soit costaud, endurant, dur au mal. Comme un boulanger. Son père, qui était effectivement avant-centre, n'en revenait pas. Voilà, c'était plié, gagné. La discussion allait être bonne, entre des gens qui avaient confiance les uns dans les autres. J'étais persuadé que ce gars-là réussirait. Deux ans après, il était meilleur buteur de la Coupe UEFA, et on a gagné la Coupe de France avec lui. Ça avait coûté son salaire et les charges sociales. En transfert, zéro.
Le modèle de l'AJA, c'était le renouvellement perpétuel, et le club a grandi via les transferts lucratifs de ses principales vedettes. Mais n'avez-vous jamais regretté de ne pas conserver une même génération sur cinq ans ou plus en vous demandant jusqu'où vous auriez pu aller ?
Mais si j'avais gardé Szarmach un an de plus, est-ce que j'aurais pris Cantona ? C'est ça ma réponse. Si nous avions pu garder les joueurs pendant très, très longtemps, ça ne servait à rien d'avoir un centre de formation canon, qui sortait des très bons. Si, comme le Paris Saint-Germain, vous récoltez les meilleurs gamins de la région, mais que vous ne les faites pas jouer, ça sert à quoi ? A part à former le futur ailier gauche du Bayern Munich ?
Dans votre livre, vous évoquez certains de vos collègues entraîneurs, dont certains nous ont malheureusement quitté l'an dernier et dont vous étiez proche, comme Robert Herbin, Michel Hidalgo ou Gérard Houllier. En revanche, vous ne mentionnez pas un autre technicien, né la même année que vous, et qui a à sa manière marqué le football français lui aussi. C'est Jean-Claude Suaudeau. On a pourtant le sentiment que vous aviez beaucoup de respect pour lui.
Envers Suaudeau, ce n'est pas du respect. C'est un sentiment d'admiration. Moi j'ai peut-être créé un certain nombre de choses mais alors, lui... Je suis un admirateur de ce qu'il a fait. De ce qu'ils ont fait. Car l'ouvreur de cette histoire à Nantes, c'est José Arribas. Arribas, c'était la racine. Suaudeau, c'est le corps. Et Denoueix, la finition, mais dans le sens de la qualité encore améliorée du modèle. J'ai essayé de savoir comment Suaudeau travaillait.
De quelle manière ?
J'ai un souvenir précis. A Limoges, nous avions affronté Nantes en amical. Le soir, Jean-Claude reste sur place pour faire une conférence devant des éducateurs de la Haute-Vienne. Je suis allé au fond de la salle, discrètement, avec un petit cahier, pour prendre des notes, comme un éducateur.
Vous lui avez "pris" des choses ?
Le toro. Tout le monde fait des toros. Mais des toros stupides. Sur une surface indéfinie, ils sont dix, douze ou quinze, un ballon et un ou deux gars au milieu. Autrement dit, il touche la balle une fois toutes les trois minutes. Le toro de Suaudeau, c'était dans un carré de 13 mètres sur 13. Et là-dedans, sept joueurs. Cinq conservant le ballon et deux essayant de le récupérer. Avec plein de variétés. En une touche, en deux touches, en trois touches, en jeu libre, avec la balle en l'air. C'est lui qui a inventé ça. Il ne touche pas de droits d'auteurs, parce que, à part moi, qui ait appliqué ça à Auxerre, personne n'a remarqué que le toro de Suaudeau était infiniment plus rentable en qualité technique que ces énormes toros qui sont juste là pour distraire mais n'améliorent pas les joueurs.
Comme Suaudeau, vous n'avez été l'homme que d'un club, en dehors de votre courte aventure lensoise. Vous dites dans votre livre que vous n'étiez peut-être pas fait pour quitter Auxerre. Vous avez pourtant failli devenir le premier entraîneur du PSG de l'ère Canal + au début des années 90...
Le PSG, c'est monsieur Brochand qui me convoque avant la fin de la saison. Je suis en fin de contrat. Il me propose de prendre le PSG. Un PSG très qualifié, avec beaucoup de bons joueurs qui vont arriver. Je me donne une semaine pour réfléchir. On se revoit huit jours plus tard. Sauf qu'entre-temps, j'ai appris que Gérard Bourgoin vient de perdre son fils dans un accident d'avion et que le fils de Jean-Claude Hamel, mon président, souffre d'une maladie grave. Alors j'ai dit non.
Vous ne vouliez pas partir dans ce contexte ?
Ces deux hommes m'ont toujours soutenu. J'aurais été le dernier des salauds à me barrer manger un gâteau aussi gros que le PSG pour les laisser dans la panade. J'ai donc expliqué aux dirigeants parisiens que je ne prenais pas le poste et c'est Artur Jorge qui est arrivé à Paris.
On ne peut pas refaire l'histoire, mais auriez-vous franchi le pas dans des circonstances différentes ?
Dans un contexte "normal", oui, j'y allais. Et j'aurais fait comme tous les entraîneurs du PSG. Je serais resté deux ans, trois ans, quatre si le parcours avait été exceptionnel. Et puis j'aurais été viré. Ça aurait été une autre manière de faire le métier.
L'autre porte de sortie qui a failli se présenter à vous, c'est l'équipe de France…
Oui, deux fois.
Racontez-nous.
La première, c'est après le France-Bulgarie, et le départ de Gérard Houllier. Là, tout le monde m'appelle et me pousse à prendre les Bleus. Même les présidents de clubs. Comme je ne suis pas trop bête, j'ai vite compris qu'ils voulaient se débarrasser de Guy Roux pour avoir un concurrent de moins. Je m'en fous de ça, ça ne compte pas. Mais j'ai une formidable bande de jeunes de 17-18 ans, certains un peu plus. Et je sens que si je parviens à compléter un peu ce groupe, on peut faire de grandes choses. Nous sommes en 1993, et trois ans après, on fait le doublé. Mon appréciation était juste. Donc là, je n'ai pas regretté de ne pas y être allé.
Et la seconde fois ?
C'est après la Coupe du monde 1998, quand Aimé Jacquet s'arrête. A nouveau, je suis pressenti, on me dit d'y aller. J'ai envie de sauter le pas. J'étais prêt mais Auxerre n'a pas voulu me lâcher. Cette fois, mon bon président Hamel me dit : "Guy, vous avez un contrat chez nous. Je ne vous fais pas l'affront de le sortir du tiroir. Vous l'avez signé, vous allez l'honorer comme j'ai honoré tous mes contrats vis-à-vis de vous." Je n'étais pas content. J'ai essayé de passer en force. Mais mes dirigeants sont allés voir Claude Simonet, le patron de la FFF, pour mettre leur veto. Ma carrière internationale s'est arrêtée là. J'étais très déçu et, sans surprise, j'ai fait la pire année de ma carrière. Pas exprès, mais le cœur n'y était pas tout à fait. Il faut le cœur, la passion.
La passion, c'est elle qui vous a permis de tenir plus de quatre décennies ?
Je vais vous donner un secret extrêmement simple. Je ne suis pas meilleur recruteur qu'un autre, ou le meilleur entraîneur du monde. Il y en a un paquet qui sont meilleurs que moi. Mais je travaillais 49 semaines par an, sept jours sur sept, onze heures par jour. Croyez-moi, là, vous faites du chemin. A moins d'être complètement con, vous arrivez à quelque chose. Mais le jour où la flamme n'est plus tout à fait là...
Mais jusqu'à cette "cassure" à la toute fin des années 90, vous n'aviez jamais eu envie ou besoin de couper ?
G.R. : Les autres me motivaient, même s'ils n'étaient pas aussi fous que moi en termes de travail. Surtout les anciens joueurs. Joueur, c'est trop beau, on a trop de latitude. Mais quand je voyais un ancien pro arriver sur le banc, ça me motivait. Luis Fernandez, par exemple, qui avait été un très grand joueur. Quand il est arrivé au PSG, je l'ai observé pendant un mois et je me suis dit "Lui, je vais le bouffer". Et en 96, je l'ai bouffé, mais ça n'a pas été facile. Quand j'ai été champion de France, je l'ai sauté dans les trois dernières journées. Et lui a gagné la Coupe des coupes. Mais il n'a pas persévéré dans la fonction...
Vous regardez toujours autant de football aujourd'hui ?
Oui.
Et lorsque vous regardez un match, avez-vous encore un regard d'entraîneur, ou de simple spectateur ?
Ah, je ne sais pas (Il réfléchit longuement). Je me paie des fantaisies. Des passions inutiles.
C'est-à-dire ?
Prenez le France-Allemagne en ouverture de l'Euro. Quand je vois comment Pogba sort son premier ballon, je me dis "Maintenant, pendant une heure et demie, tu ne le quittes pas des yeux, tu vas en avoir plein la vue." Et j'en ai eu plein la vue.
Qui d'autre suivez-vous particulièrement dans cette équipe de France ?
Le petit Griezmann. J'ai une tendresse particulière pour lui parce qu'il est de Mâcon. L'AJA, en mon absence, l'a loupé. Ils l'ont vu dans un tournoi et ne l'ont pas pris parce qu'il était trop petit. Griezmann, même quand il est un peu en difficulté sur certains matches, ce n'est jamais grave. Il se bat tellement comme un lion que ça ne fera jamais un grand déficit pour l'équipe même s'il n'est pas dans un grand jour.
Et parmi les entraîneurs actuels, en qui vous reconnaissez-vous ?
Jürgen Klopp, c'est un peu le même genre que moi. Il n'a pas la même histoire, bien sûr. Mais dans le management des hommes, c'est pareil. Carlo Ancelotti, aussi. Tous ses joueurs ont dit qu'il était formidable, agréable. Moi, il y en a peut-être 10% qui diraient que je ne suis pas agréable. Mais parfois, même ceux avec qui j'ai eu un gros conflit, je m'entends bien avec eux aujourd'hui.
Vous qui étiez constamment derrière vos joueurs, les plus jeunes notamment, pour les "surveiller", comment géreriez-vous un groupe aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux ?
J'ai commencé comme entraîneur avec un cahier, une page remplie chaque jour. Avec Cuperly (Dominique Cuperly, son adjoint), on faisait nos tableaux au Bic. Tout le programme de l'entraînement était écrit sur cahier. A la fin du mois, on revoyait toutes nos notes, tous les chiffres, et on adaptait.
C'était vos "datas" à vous, en quelque sorte ?
Vous appelez ça datas ? Je ne connais même pas le vocabulaire, moi. J'ai fait une sorte d'aristocratie du fait de ne pas venir dans le monde moderne. Mais les réseaux sociaux, je m'y serais mis. Croyez-moi que si j'en avais eu besoin pour le travail, je m'y serais mis.
Est-ce que le banc vous manque encore, au quotidien ?
Non, c'est fini. Ça a duré deux, trois ans. Physiquement, je n'aurais pas pu continuer plus de deux ou trois ans. Et aujourd'hui, j'en serais incapable. Je n'ai plus, en moi, la force de persuasion que j'avais. Quand je prenais mes joueurs, un à un, pour leur parler, à la fin de mon propos, il fallait qu'ils soient complètement imbibés. Ou alors j'avais raté mon coup. Je pouvais les convaincre de tout.
Si vous deviez résumer l'entraîneur Guy Roux d'une formule, laquelle serait-elle ?
Je n'ai rien inventé, j'ai tout capté.
Par Laurent Vergne pour Eurosport.