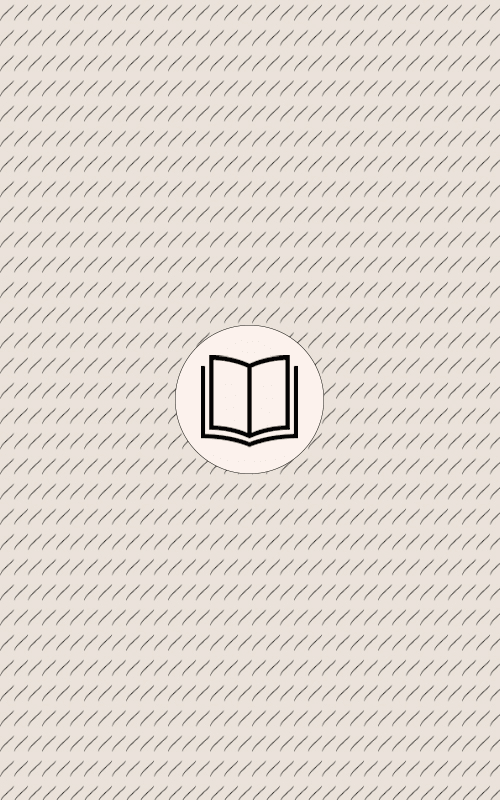Fils de militaire, également agent des services, Richard Volange (un nom d’emprunt) a décidé de raconter dans un ouvrage passionnant (Espion, 44 ans à la DGSE) la cuisine interne de la Direction générale des services extérieurs (DGSE). En particulier, à l’étage de la mythique «section N», celle qui traite de l’Afrique. Les coups fourrés n’ont pas manqué, les gueuletons à coups de caviar, non plus. Un univers en train de changer, notamment sous la pression de la surveillance numérique.
Pendant plus de vingt ans, vous avez travaillé pour la DGSE sur le continent africain. Quel regard rétrospectif portez-vous sur cette période ?
C’était l’âge d’or de la Françafrique… Après la vague des indépendances en 1960, la France a toujours voulu conserver son emprise sur ses ex-colonies, notamment à travers l’exploitation des matières premières. Bien sûr, il y avait aussi l’importance des votes à l’ONU, son influence, qui sécurisaient le rang de la France comme grande puissance. Mais il ne faut pas négliger la dimension strictement financière. Les ex-colonies sont devenues souveraines. Mais pas pour leur sous-sol, qui ne leur appartenait toujours pas. Dans les accords de défense secrets, je les ai lus, il y avait toujours un volet sur les ressources stratégiques. En 1973, au moment du choc pétrolier, c’est ce qui nous a permis de continuer à profiter du pétrole venu du Gabon ou du Congo-Brazzaville, contrairement à d’autres pays occidentaux qui ont subi des pénuries. Il y avait un contrôle permanent sur les dirigeants africains, pour éviter qu’ils aient la velléité de sortir du giron français. Surtout pour les pays qui avaient des ressources minières.
Et d’ailleurs ceux qui remettaient en cause ce statut quo, étaient poussés vers la sortie, ou renversés ?
Exactement. Ce fut le cas pour Ange-Félix Patassé à la tête de la Centrafrique entre 1993 et 2003. Il avait un regard assez dur sur la période coloniale. Tout en étant lui-même très corrompu. On a préféré s’en débarrasser. Il sera renversé lors d’un coup d’Etat, par François Bozizé. Par la suite, en poste à Bangui à partir de 2005, je vais devenir le conseiller sécurité de ce président. Souvent, j’allais le voir tard dans la nuit, vers 23 heures. Je croisais parfois l’ambassadeur des Etats-Unis qui poireautait dans la salle d’attente, et qui me voyait passer avant lui ! Ça l’agaçait un peu.
Le même scénario s’est produit au Congo-Brazzaville…
Plusieurs pays africains ont connu des élections libres dans la foulée du discours de La Baule de 1990, lorsque François Mitterrand a lié pour la première fois démocratisation et aide au développement. Mais c’était souvent des démocraties de façade, sans projet, sur des bases ethniques. Au Congo-Brazzaville, Pascal Lissouba a lui aussi été élu démocratiquement en 1992. J’étais à l’époque rédacteur du dossier de ce pays. Lissouba était très populaire, notamment auprès des Bateke, son ethnie. Reste qu’il a voulu remettre en cause les avantages fiscaux accordés à la compagnie française Elf qui exploitait le pétrole sur place. S’il n’avait pas fait ça, l’histoire se serait peut-être écrite autrement. Mais là, il a franchi la ligne rouge. C’était impensable. Mon chef était alors en liaison directe avec le ministère de la Coopération. A l’époque l’ambassadeur dans ces pays, c’était quasiment une potiche. C’est le conseiller économique qui avait le vrai pouvoir. Et il dépendait de la Coopération qui pilotait tout. A Brazzaville, on a alors soutenu Denis Sassou-Nguesso qui avait été évincé par les élections au profit de Lissouba. Il va revenir au pouvoir au prix d’une guerre effroyable en 1997. Il y est toujours.
La France a donc contribué à déloger en Afrique des régimes qui pourraient lui être défavorables… Au point de contrecarrer des oppositions ou des rébellions ?
En Afrique, et notamment au Tchad et en Centrafrique, on a sauvé maintes fois les régimes qu’on soutenait. Notamment face à des rébellions armées. Quand j’étais en poste à Bangui, à deux reprises au moins, en 2006 et 2007, on a envoyé des mirages et des troupes au sol qui ont fait un véritable carton face à des mouvements rebelles à Birao, dans le nord-est du pays. Une de mes sources qui était sur place et a survécu en a été durablement traumatisée. Il a pourtant suffi à l’époque d’un coup de fil de l’Elysée pour envoyer l’artillerie lourde pulvériser la rébellion. Puis Bozizé a cherché à se rapprocher des Chinois, à s’émanciper de la tutelle tchadienne. Lorsqu’une nouvelle rébellion est apparue en 2013, on l’a laissé tomber.
Quelles conséquences cette stratégie a-t-elle aujourd’hui sur nos relations avec ces pays africains ?
La vérité, c’est que tout le monde a exploité l’Afrique. Personne ne s’intéresse au quotidien des Africains. Mais en ce qui concerne la France, le basculement a commencé dès les années 90. Peu à peu, a émergé une nouvelle génération d’Africains, moins fataliste que leurs parents, plus ouverte sur le reste du monde. Et plus critique vis-à-vis de la France. On a souffert d’une approche restée trop longtemps exclusivement politico-sécuritaire. L’aide au développement, c’était bidon, on s’est contenté du strict minimum. Alors que dans le même temps, en Centrafrique par exemple, on accordait au début des années 2000, une rétrocommission de 8,5 millions d’euros à Bozizé pour assurer à Areva l’exploitation d’une mine d’uranium. Un projet qui sera finalement peu viable, et donc vite abandonné. Et puis au quotidien, il y avait souvent le comportement des gens de l’ambassade. Des diplomates qui gagnaient autour de 10 000 euros par mois, mais pinaillaient pour augmenter de deux ou trois euros le salaire très modeste de leurs employés. Bref, il ne faut pas s’étonner aujourd’hui que tant d’Africains dans ces pays ne voient leur avenir que dans la migration. Par désespoir. Ni être surpris qu’il existe désormais un sentiment antifrançais sur le continent.
Reste que ce sentiment antifrançais est aujourd’hui exploité par la Russie. Quelles étaient vos relations avec les Russes ?
Elles ont longtemps été plutôt cordiales. Ils nous aimaient bien, même au temps de la guerre froide. Sans aucune perversité. Car les Russes souhaitaient surtout avoir une présence d’influence. Sauf en Angola, avec les diamants. Encore aujourd’hui, c’est avant tout du sécuritaire qu’ils proposent. Je me souviens d’avoir été en Guinée en 1992. Les Russes nous offraient du caviar. Et nous, on leur offrait du gin, des trucs comme ça. En 2016, alors que j’étais en poste à Djibouti, ils nous ont même demandé s’ils pouvaient occuper une partie de notre base militaire. On a refusé bien sûr. Mais aujourd’hui, même cette proposition ne pourrait plus être formulée.
A Djibouti justement, vous avez découvert un nouvel aspect de l’offensive chinoise sur le continent. Avec la construction de la première base militaire chinoise à l’étranger en 2017…
On n’avait accès à rien, et c’est vite devenu mon obsession sur place. J’ai tout essayé pour avoir des infos sur ce qui se passait à l’intérieur de cette base. Jusqu’à recruter des prostituées. Mais ils en faisaient venir de Chine, logées dans un bâtiment en ville. Les Chinois ont réussi à s’isoler, de façon très opaque, même en Afrique. Le business est tout aussi secret, souvent contrôlé par d’anciens diplomates ou militaires. Reste qu’ils ont réussi là où nous avons échoué : Ils ont construit des routes, des ponts, des hôpitaux. Certes souvent low-cost, et au prix de l’endettement accru des pays concernés. Mais ils ne sont pas faits rejeter, alors qu’ils fréquentent peu les Africains, et ont souvent une forme de mépris. En ce qui concerne la base militaire à Djibouti, j’ai fini par percer le mystère grâce à une jeune prof de français, employée sur place. Sauf que les services américains ont tenté de retourner cette recrue, alors même qu’on était censé collaborer. J’étais furieux quand je l’ai découvert.
Vous avez eu parfois des relations compliquées avec les services américains, pourtant censés être nos alliés. Surtout dans la lutte antiterroriste qui s’impose après le 11 septembre 2001…
On a réussi ensemble un coup d’éclat, certainement le plus important de ma carrière : l’arrestation de Peter Cherif, l’homme qui est censé être le cerveau de l’attentat contre Charlie Hebdo en 2015. Il avait fui au Yémen, on l’a retrouvé à Djibouti, grâce au compte Facebook de sa femme. Les Américains sont nos alliés et ils peuvent être charmants, très coopératifs. Jusqu’au jour où ça ne les arrange plus. Ils opèrent alors sans prévenir un virage à 180 degrés. En réalité, ils ne défendent que leurs propres intérêts. Ils ont un complexe de domination et se considèrent comme les maîtres du monde.
Mais, comme vous le soulignez dans votre livre, les Américains sont bien plus puissants que les Français.
C’est vrai : la NSA peut aligner 10 000 agents, là où nous, on peine à en impliquer 2 000…
Vous affirmez également que la CIA est la seule agence au monde à pouvoir «craquer» la confidentialité de certaines messageries, comme WhatsApp. On a du mal à vous croire…
En réalité, avec WhatsApp, avec nos moyens nous pourrions récupérer un message, et encore pas toujours en entier, au moment précis où vous avez fini de le rédiger, alors que vous vous apprêtez à appuyer sur «envoyer». Mais ça demande une mobilisation et une énergie folles. Du coup, il est bien plus rentable d’envoyer un message avec un lien, transmis de préférence par un proche, doté d’un Spyware, un logiciel espion. Dès que vous cliquez sur le lien, tout le contenu de votre portable est accessible. Et vous l’ignorez.
La montée en puissance de la surveillance numérique a changé le travail des services secrets en France comme ailleurs. Au risque de perdre ce qui, selon vous, a longtemps constitué «l’ADN des services français», le renseignement humain ?
Oui et c’est lié à un problème de formation et d’expérience. Traditionnellement les services français recrutaient auprès des militaires et de la fonction publique. Aujourd’hui l’immense majorité des nouvelles recrues viennent de Sciences-Po, parfois séduites par la série le Bureau des légendes. Mais ils rechignent à partir plusieurs années en poste à l’étranger, et notamment en Afrique. Ils fréquentent des chercheurs. Sont le nez sur leurs écrans, les oreilles vissées à leurs casques, fascinés par les nouvelles technologies, les drones. Ils baignent dans le virtuel et croient tout connaître. Ce n’est pas leur faute, puisque leur hiérarchie le cautionne. Les plus âgés, comme moi, ont été poussés vers la sortie. Pourtant, cette dévalorisation du renseignement humain, qui réclame de la patience, du contact, nous a déjà valu des échecs. Et notamment en Afrique de l’Ouest, où l’on a été pris au dépourvu par trois coups d’Etat successifs. Faute d’être restés connectés avec les bons réseaux sur place.
Par Maria Malagardis pour Libération.